J’avais longuement parlé de la guerre avec DOA dans un entretien réalisé au moment de la sortie de « Pukhtu primo » et en accord avec l’auteur, il m’a semblé plus judicieux d’évoquer son parcours d’écrivain depuis « Citoyens clandestins » qui inaugure le cycle jusqu’à ce « Secundo » sans négliger par ailleurs sa riche collaboration avec Dominique Manotti pour « l’honorable société ». Comme à son habitude, DOA s’exprime sans mâcher ses mots. Enjoy!

La sortie d’un roman, c’est sûrement une période de doute, qu’en est-il pour vous ? Vu que c’est la sortie de la deuxième partie de « Pukhtu », l’angoisse est-elle moindre, différente ou tout simplement magnifiée ?
De quoi parle-t-on, de doute ou d’angoisse ? Je ne doute pas. Ce « Pukhtu », c’était ce que je pouvais écrire de mieux au moment où je l’ai rédigé. Ce ne sera sans doute plus vrai dans un an ou deux, du moins je l’espère, mais dans l’immédiat je ne pouvais pas aller plus haut, plus fort. Par ailleurs, le texte correspond à ce que j’avais en tête. Il n’y a donc aucun problème de ce côté-là. Néanmoins, je suis partagé entre deux émotions : le soulagement heureux, parce que c’est enfin terminé, les gens vont pouvoir juger l’ensemble, et l’angoisse, parce que j’aimerais, par mégalomanie sans doute, voir mon travail rencontrer un très large public. Ces six années de turbin acharné, de saines mais épuisantes remises en cause, de réflexions et d’arbitrages, elles ont nourri ma vie personnelle et ont été nourries par elle. Il était temps que cela s’achève et il serait bien que cela paye (ça y est, j’ai dit un premier gros mot – sourire).
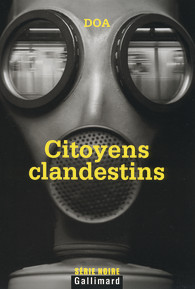
Si on revient en arrière, dix ans plus tôt, quand vous commencez à écrire «Citoyens Clandestins », est-ce que vous savez déjà que vont succéder à ce roman « le serpent aux mille coupures » et « Pukhtu » ?
Non. « Citoyens » a été pensé comme un récit unique et c’est la (surprenante) popularité de l’un de ses principaux personnages qui a déclenché la réflexion sur une ou plusieurs suites éventuelles. En revanche, une fois cette cogitation amorcée, il a toujours été très clair pour moi que je ne suivrais pas la voie de « héros » récurrents apparaissant dans des récits conçus comme autant d’épisodes, avec un potentiel quasi infini, mais comme les acteurs d’un tout limité dans le temps et le nombre de volumes.
Pourquoi inattendu, pensez-vous qu’il existe des canons universels pour un héros et s’agit-il de Lynx ou de Fennec ?
Inattendu, parce que je ne donnais pas cher de la réputation d’un agent clandestin tortionnaire et assassin d’état a priori. Il faut se souvenir du contexte de l’époque. En Iraq, le conflit s’envenime et s’enlise, et c’est aussi le moment où sont sorties les histoires de kidnappings, vols secrets et tortures de la CIA. Honnêtement, j’aurais pu me faire lyncher pour ce roman et surtout ce personnage (c’est ce qui est arrivé au film « Zero dark thirty », sorti en 2012, attaqué par la critique pour sa façon de rendre compte de la torture). Il n’en a rien été. Pire, beaucoup de lecteurs se sont entichés de mon loup cervier.
Quelle est la genèse de « Citoyens clandestins » si éloigné de votre précédent roman « la ligne de sang » ? Une envie d’écrire sur les magouilles peu connues des gens qui finalement dirigent la planète, un événement, une conscience politique ? J’imagine qu’on ne se lève pas un matin en se disant « tiens, je vais écrire Citoyens clandestins, aujourd’hui, moi ».
Je n’ai aucune conscience politique (rires) et je ne cherche pas à faire passer de message dans mes textes. Le réel m’intéresse uniquement comme matière première à façonner, dans laquelle intégrer des éléments et des figures de fiction à mon goût. Le point de départ de « Citoyens » est donc, aussi étonnant que cela puisse paraître, véritablement trivial, c’est la combinaison de l’attentat du 11 septembre et de la question : « Et ici, on pourrait faire quoi ? » Quand on voit l’actualité, on s’aperçoit que c’était vraiment n’importe quoi, ce roman.
Est-ce le succès de ce roman récompensé par le grand prix de la littérature policière dont le jury se trompe rarement qui vous incite à retourner dans des histoires sombres et secrètes avec « le serpent… » ? Avez-vous déjà en tête le projet grandiose « Pukhtu » ?
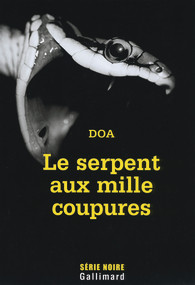
Le Grand Prix de Littérature Policière, un gage de qualité effectivement – qui a néanmoins préféré « La princesse des glaces » à « La griffe du chien », il faut s’en souvenir au moment où la suite de ce dernier roman, « Cartel », recueille un grand nombre de critiques élogieuses de la part du milieu du polar – est décerné chaque année fin septembre. En général, pour les auteurs honorés, les romans sont publiés depuis au moins six mois. Le succès, si succès il y a, est déjà en cours. Ou plus. Ou n’a jamais eu lieu. Le prix relance un peu les ventes mais ne les fait pas décoller. Le phénomène n’a rien de comparable, loin de là, avec celui qui propulse en tête des classements les livres primés par l’une des récompenses d’automne de la littérature générale (Goncourt, Renaudot, etc.) qui, de plus, interviennent dans les deux ou trois mois suivant leur publication. Si « Citoyens » a pu marquer un peu les esprits à l’époque de sa sortie, c’est seulement à partir de son édition de poche que son lectorat s’est développé de façon remarquable. Le prix m’a surtout aidé à cette étape-là. Mais, ainsi que je l’ai expliqué plus haut, ce n’est pas cela qui a déclenché mon envie de plus, c’est l’inattendu potentiel empathique de l’un de ses personnages principaux auprès du public.
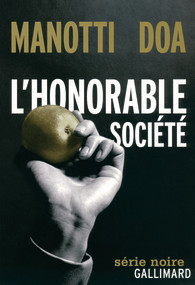
Vient ensuite « L’honorable société » et une collaboration avec Dominique Manotti qui coulait de source. Qu’est-ce que l’écriture à quatre mains avec cette grande dame du polar vous a apporté ?
Beaucoup de plaisir, des moments complices, une belle amitié et, d’un point de vue technique, l’obligation d’écrire au présent. Une révolution en ce qui me concerne. En m’imposant cette contrainte, Dominique a influencé et, selon moi, fait progresser mon travail plus profondément que n’importe quel autre écrivain.
Cette révolution dans votre style née d’une contrainte technique vous obligeant à utiliser le présent de narration, c’est donc plus difficile d’écrire au présent ? Quels automatismes cela demande-t-il d’acquérir qui soient plus tordus que la maîtrise de la concordance des temps ?
D’abord, la problématique de la concordance ne disparaît pas avec le présent. Ensuite, ce n’est pas plus difficile, ce n’est juste pas l’usage en littérature française, qui fait la part belle à l’imparfait et au passé simple, temps de la narration. Le présent c’est l’immédiateté, le mouvement, l’action, la proximité et donc, en poussant le raisonnement, le réel. Raison pour laquelle il est employé par la presse, par exemple. Et la littérature anglo-saxonne. Il incite
naturellement à la sécheresse, à la traque du superflu, essentielle à tout roman de qualité. Le problème, c’est que l’on peut rapidement passer de l’assèchement à l’aridité. Or l’écrit de fiction, me semble-t-il, a besoin de garder un minimum de gourmandise, de chair, pour embarquer un lecteur, le séduire. La difficulté de l’usage du présent est donc là, dans le juste équilibre et la conservation d’un bon « cholestérol » littéraire.
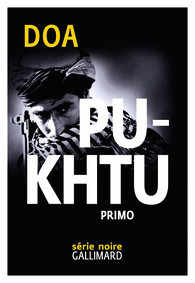
Qui décide que Pukhtu sera en deux parties avec une attente de plus de 18 mois pour le lecteur, vous ou des contraintes éditoriales ?
La taille que prend le récit à mesure que je l’écris (qui dépasse mes prévisions), l’anticipation des réactions des critiques (qui râlent quand un Français écrit trop épais), des lecteurs (qui prennent facilement peur pour la même raison), moi (qui le suggère), Aurélien Masson, mon éditeur (qui l’accepte), la promo de « Pukhtu Primo » (qui décale la reprise du travail de rédaction de quatre mois), la fatigue accumulée au cours des deux années et demie précédentes (qui me ralentit, je ne suis pas un robot) et le temps nécessaire à Gallimard pour la fabrication d’un livre à partir d’un manuscrit définitif (qui prend entre quatre et cinq mois).
Au fil des entretiens et des conversations « off » c’est un plaisir de constater que vous ne pratiquez pas la langue de bois et je suis très surpris que vous parliez de l’influence de la critique. Pensez-vous ou avez-vous constaté que la critique professionnelle peut faire le succès d’un livre ?
Je ne parle pas de l’influence de la critique mais des « réactions des critiques » face à la taille d’un livre. Quelle est l’influence qu’ils exercent réellement, cette question n’a pas de réponse évidente. On a vu des bouquins très soutenus par la presse ne pas se vendre et d’autres, pas du tout exposés dans les médias, partir comme des petits pains. Empiriquement, compte tenu du nombre de titres publiés chaque année et de la concurrence de fait qui s’exerce entre les auteurs pour obtenir une part du budget « livres » des lecteurs – je ne dis pas que c’est ce que nous cherchons mais c’est quand même un peu ce qui nous arrive quand nous nous retrouvons tous alignés en rangs d’oignons sur les tables des libraires – j’aurais tendance à croire qu’il vaut mieux être « critiqué » – à prendre au sens large – qu’ignoré par les organes vecteurs de visibilité. Et, retour à mon propos initial, pour plein de raisons, les journalistes en charge des pages ou des émissions littéraires ont tendance à renâcler devant les gros romans. C’est compréhensible quand on sait le nombre de textes dont ils sont destinataires chaque année, moins lorsque l’on constate l’existence d’une véritable prime à l’exotisme, assez injuste, qui tend à les rendre bien mieux disposés à l’égard des « pavés » étrangers, anglo-saxons en particulier. J’emploie le terme « pavé » à dessein, parce que vous le retrouverez très souvent utilisé lorsqu’il s’agit de chroniquer un ouvrage français de taille conséquente et quasiment jamais pour son équivalent d’ailleurs. Comme s’il était, dans le premier cas, indispensable de « prévenir » le potentiel lecteur, mais pas dans le second, où l’on préférera louer l’ampleur littéraire et pas faire référence à son véritable encombrement physique. Pourquoi ? Mystère.
Savez-vous en démarrant ce « monstre » que vous êtes parti pour 1317 pages sans les annexes ? Avez-vous eu la pleine conscience de l’épreuve qui vous attendait ou tel Colomb si vous aviez su que cela serait si terrible vous n’auriez jamais entrepris le voyage ?
Je tablais sur mille pages en un seul volume. Je me suis trompé. Je pressentais / craignais que ce serait long et difficile, mais pas assez pour ne pas tenter l’aventure. Si un auteur ne se fait pas mal, ne prend pas de risques en accouchant de ses romans, valent-ils la peine d’être écrits et, plus encore, d’être lus ?
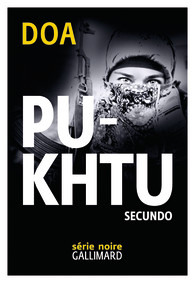
Je suppose que les recherches documentaires pour ce genre de roman qui se promène sur quatre continents ont dû être pharaoniques, mis à part celles que vous ne pouvez citer, comment trouvez-vous vos sources ? Vous êtes-vous rendu à Ponta Do Ouro par exemple ?
Les sources, elles sont multiples et nombreuses. Certaines sont plus longues et pénibles à obtenir que d’autres, il faut être créatif, patient et réactif – et parfois n’avoir pas (trop) peur – mais aucune n’est inaccessible. Quand on cherche, on trouve, une vérité intangible, encore plus aujourd’hui que dans le passé. Et pour répondre à votre question sur Ponta do Ouro, oui, j’y suis allé, trois fois. La dernière, c’était en 2009. Mon meilleur ami, sud-africain et plongeur comme moi, possédait une petite maison là-bas. Il l’a revendue il y a quatre ans, l’endroit, devenu très (trop) touristique, ayant perdu son charme rustique. Un détail : le vrai nom du Cafe do Sol a longtemps été Cafe del Mar. Pour les curieux, il s’appelle maintenant Cafe Batuque.
Peut-on avoir un plan quand on écrit un tel roman, la trame reste-t-elle figée ?
Avoir un plan n’est pas une option, c’est une nécessité absolue. Et un plan bien conçu permet, au moment de l’écriture, de faire évoluer les arcs narratifs prévus. La solidité de ses fondations autorise chamboulements et spontanéité. Ainsi, pour « Pukhtu », le personnage de l’enfant à la fleur n’était mentionné nulle part dans mon plan, il n’existait pas. Il est apparu au détour d’une scène, dans le décor, pendant la rédaction, et s’est mis à suivre Shere Khan à la trace dans ses aventures. Chose extraordinaire, il a même fini par s’inscrire parfaitement dans l’une des thématiques sous-jacentes du récit, relative à l’enfance, la filiation, la parentalité.
Qui peut mieux que vous peut le faire… Comment présenteriez-vous votre roman ou plutôt chacune des deux parties qui sont finalement assez différentes ?
Des tas de gens pourraient le faire mieux que moi, je manque de recul et ne me vois pas en « représentant » de mon travail. Je ne peux que renvoyer aux quatrièmes de couverture de « Primo » et « Secundo », identiques, puisque tous les thèmes abordés s’y trouvent mentionnés. C’est un long voyage, mouvementé, souvent difficile, parfois grandiose, à travers le monde d’aujourd’hui – son versant noir et caché s’entend – mais, à l’instar de tous les périples lointains, il est exigeant et se mérite. Quant aux deux parties, leur différence perçue est surtout la conséquence de leur séparation physique. Lue dans la continuité, la seconde moitié apparaît pour ce qu’elle est, l’évolution logique de la première, un resserrement du général au détail et au personnel.
Et voilà, vous ne voulez pas être le « représentant » de votre livre mais vous en êtes néanmoins le créateur ce qui fait de vous la personne qui le connait le mieux et votre démonstration à l’instant le prouve sans appel. Vous avez la vérité et les lecteurs ne pourront avoir que des interprétations de votre réalité.
Oui, un créateur qui a mis, comme vous l’avez fait remarquer plus haut, 1317 pages sans les annexes et six ans à raconter sa putain d’histoire, et pas quelques lignes et cinq minutes. Il faut croire que je ne savais pas faire autrement. Aucune condensation ne peut rendre justice à un travail tel que celui-ci quand vous en êtes l’auteur. Il me semble donc que seul un lecteur, avec son oeil neuf et son recul de découvreur, est en mesure de faire ce genre de présentation, par le truchement de son ressenti et de ce que sa mémoire a retenu, de son expérience personnelle du texte donc. S’il a aimé. Et même s’il a détesté.
Vous écrivez Secundo à l’automne 2015 quand en France, on s’aperçoit que la barbarie très lointaine que vous racontez dans Pukhtu est entrée dans Paris. A moins que vous vous soyez coupé du monde à ce moment-là, quels sont vos sentiments ? Les attentats qui se déroulent en France ont-ils un impact sur votre écrit ?
Il aurait été difficile pour moi d’ignorer les attentats de l’automne 2015, j’habite à cent cinquante mètres du Bataclan. Je n’ai pas eu peur. Et je n’ai pas été surpris. Ou accablé ensuite (mais je n’ai perdu personne, moi). Pour diverses raisons, je vis avec la certitude d’attaques terroristes chez nous, surtout islamistes, depuis très longtemps. La France, jusqu’à un passé récent, s’est crue à l’abri, aidée en cela par le mythe d’un renseignement national efficace et de gouvernements successifs prompts à nous endormir sur le sujet. Nous n’étions en réalité pas en sécurité, bien au-delà des pires anticipations, et nous en faisons l’amère expérience depuis non pas deux, mais presque cinq ans, puisque la première véritable alerte sanglante, après une longue période de calme trompeur, du genre à précéder les tempêtes, c’était Mohammed Merah, en mars 2012. En pleine campagne présidentielle, rappelons-nous en. De fait, tous les prétendants à l’Elysée ont, ce mois-là, entendu le coup de semonce. En théorie. Donc ni peur, ni surprise, ni déprime. Beaucoup de colère, en revanche, ne serait-ce que vis-à-vis du sommet de l’état, parce que ce qui arrive n’est pas une fatalité, c’est le résultat de la négligence, de l’incompétence, de l’aveuglement idéologique, de la veulerie et d’une culture de l’opportunisme politique des plus crasses. Merah est un échec cuisant de l’administration française. Un ratage magistral, j’insiste. Un retour d’expérience digne de ce nom, demandé par de vrais dirigeants, un minimum connaisseurs, aurait conduit à de profondes réformes dans l’organisation de tous les services concernés – police, justice, défense – au renouvellement de leurs échelons de commandement et de leurs effectifs, à la remise à niveau du recrutement et de la formation de leurs fonctionnaires, ainsi que de leurs procédures de contrôle (fiches S, entre autres). Il n’en a rien été, on a distribué des médailles en chocolat pour cacher la misère et après, fermez le ban, circulez, il n’y a plus rien à voir. Ensuite non plus, on n’a rien fait « pour de vrai », malgré la multiplication des attaques (presque autant d’autres ratages). Les mêmes sont toujours là et font toujours la même chose, mal, peu efficace. Plusieurs vagues d’individus, qui ne sont pas les « déséquilibrés » ou les « loups solitaires » qu’on essaie de nous vendre à chaque fois, mais dont on ne peut pas dire non plus qu’ils brillent par leur intelligence, ni même par leur expérience réelle du combat clandestin, ont infligé de sérieux revers – et ce n’est pas terminé – à nos appareils policier et de renseignement, y compris de l’extérieur, et judiciaire. En termes plus crus, on n’arrête pas de se retrouver le pantalon sur les chevilles, cul nu, à se faire dérouiller par des « cosmotruffes ». Et le nombre de morts et de blessés, de victimes collatérales – leurs proches – augmente mois après mois. Qu’est-ce que cela dit sur nous ? Et que signifie notre absence de réaction en tant que peuple ? Ne serait-ce que pour demander des comptes à nos gouvernants, à leurs prédécesseurs, à ceux qui prétendent leur succéder, tous issus du même monde ou pas loin, celui des héritiers et des rentiers de la politique et de la haute fonction publique, mais aussi aux gens censés leur obéir et nous protéger, et à toute la clique d’observateurs et d’« apostériologues » bavards qui se targuent de représenter un vital contre-pouvoir ? Sinon non, aucune influence sur mon récit, même si celui-ci, dans ce qu’il raconte en creux sur les services secrets français, n’est pas sans rapport avec la saillie ci-dessus.
Voterez-vous à la prochaine élection ? Que redoutez-vous le plus pour la sécurité du pays ? Le vote d’un peuple apathique ou une nouvelle présidence identique aux précédentes ? Chaque nouveau président met aux postes clés des renseignements, des services secrets, de la diplomatie et du gouvernement des amis ou des valets fidèles, quel candidat vous fait le plus peur sur le dossier de la sécurité intérieure qui sera un des grands thèmes de la campagne ?
J’ai l’impression d’être déjà suffisamment sorti de mon rôle avec ma réponse précédente et, n’étant pas plus qu’un autre à l’abri du syndrome du café du commerce, je vais éviter de m’étendre sur le sujet. Aucun des candidats déclarés à ce jour ne me semble à la hauteur de la fonction auxquels tous aspirent et je ne vois pas, à moyen terme, comment pourraient émerger des profils, femmes et / ou hommes, ayant la légitimité, la carrure, l’intégrité et la vision suffisantes. Il appartient donc, selon moi, à chacun de décider s’il doit ou non voter pour le moins « pire » ou « flippant » à son avis. Ou prendre le maquis (sourire).
David Joy raconte qu’il a attaché son personnage principal à un morceau de musique afin de le garder bien en tête dans son roman, avez-vous vous-même un truc qui vous permet de le garder bien en tête ? Il y a à peu près dix ans d’écart entre la création de Montana dans « Citoyens clandestins » et sa présence dans Secundo et même si cela représente une durée bien moindre dans le roman, comment faites-vous pour conserver le même homme avec la même psychologie?
D’une part, Alain Montana n’est pas un personnage principal, il tient dans mes écrits un rôle important certes, mais secondaire. D’autre part, comme David Joy j’imagine, je construis des biographies pour mes protagonistes, tous, surtout factuelles : année et lieu de naissance, parcours scolaire, professionnel, environnement familial, parfois des ébauches de motivations. Cela me donne un cadre général et un type, assez grossier, de personnalité, auxquels je
m’efforce de rester fidèle. Une fois dans le texte, j’affine en fonction de ces contraintes et des contraintes que pose le récit lui-même. Ainsi, au fur et à mesure des péripéties traversées, les caractères se précisent. Pour reprendre l’exemple de Montana, c’est le même homme sans l’être, il a vécu, son profil psychologique n’est pas totalement éloigné de ce qu’il était avant, mais il a évolué. La seule difficulté au moment de le faire intervenir était donc de l’incarner par les bons mots, en se souvenant d’où il venait et en s’interrogeant sur son « mûrissement » probable au fil des ans et des évènements, rien d’insurmontable. J’ajoute que le coeur véritable du travail du romancier se trouve là, pas dans la documentation.
Il n’y aurait pas un petit côté macho chez vous avec ses personnages féminins qu’on aime mais qu’on doit néanmoins toujours sauver ou protéger ?
Postulat : le lecteur a tous les droits, y compris celui de penser que je suis un « macho ». Et vous avez raison, j’aurais dû, au moment de construire le roman, interroger à ce sujet les intermédiaires de l’ombre – sur le terrain, dans le vrai monde, très majoritairement des hommes – qui s’occupent de négocier, rechercher, escorter, secourir des otages – capturés par d’autres hommes – comme la femme politique Ingrid Betancourt, les humanitaires Margaret Hassan, Christina Meier, Clementina Cantoni, Linda Norgrove, Anetta Flanigan, Cydney Mizell, Simona Pari et Simona Toretta, les journalistes Melissa Fung, Joanie de Rijke ou Florence Aubenas, entre autres, pour savoir s’ils avaient « un petit côté macho » qui sauve les « femelles » en détresse. Je suis sûr que Nicola Calipari, du SISMI, aurait eu des trucs intéressants à me dire s’il n’avait pas été tué – par des soldats US – en raccompagnant Giuliana Sgrena, une des plumes d’« Il Manifesto », à l’aéroport de Bagdad après avoir participé à sa libération. J’aurais même pu aller plus loin et leur demander à tous s’ils ne sont pas carrément phallocrates lorsqu’ils préfèrent s’occuper plutôt des mecs kidnappés sur les différents fronts ouverts ces dernières années. Plus sérieusement, auriez-vous posé la question à un auteur étranger, en particulier américain, sachant que la production littéraire de ce pays, dont on salue souvent la prise avec le réel, nous abreuve de ce genre de figures narratives ?
Vous avez déjà dit que « Pukhtu » était la fin d’un cycle et sans me faire la moindre illusion sur une réponse, avez-vous des projets d’écriture ?
Il y a quelques jours, j’ai déclaré à un autre interlocuteur que j’abandonnais les « barbus », pour me concentrer sur l’épilé – un premier récit, à venir dans deux ans a priori – et le glabre – un second roman, dont la construction et l’écriture réclameront plus de temps.
Parce que la dernière fois j’avais oublié de vous le demander, sinon comment ça va la vie ?
Très bien, le pire est à venir, je ne vais pas manquer de sujets de réflexion.
Encore merci et surtout, surtout, bravo.
Merci à vous d’avoir pris la peine de me lire et m’interroger.
Entretien réalisé par mail fin septembre dans un premier temps et complété par des relances à certaines réponses et des échanges off parfois « chauds »… Je ne saurai trop remercier DOA pour le temps consacré et les lumières apportées.
Wollanup le 14 / 10 / 2016.


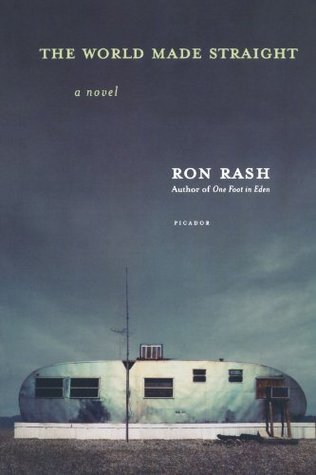


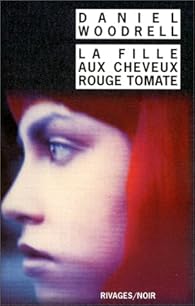
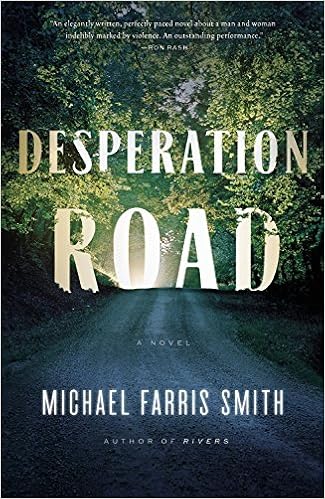














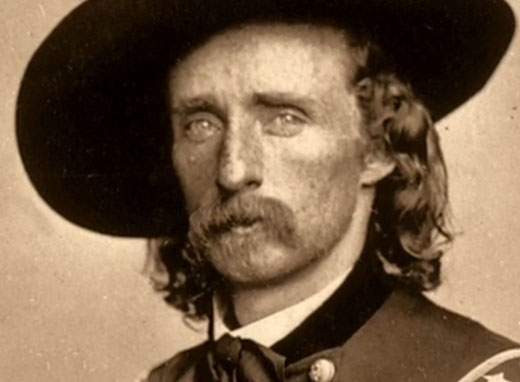








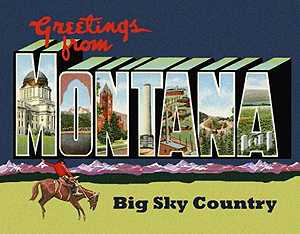






Commentaires récents