
Riche, beau, savoureux, toujours prenant, et horrible ; du Grand Art.
« On peut dire que le genre de chance dont vous avez bénéficié ressemblait fortement à celle décrite par Sénèque. La rencontre de l’opportunité et de la préparation. »
Il faut avant tout dans cet admirable roman, après le talent de Philippe Kerr, féliciter la traduction de Philippe Bonnet. Cette phrase sort de la bouche de Somerset Maugham, vieil écrivain – dans le livre – anglais homosexuel, et, au delà de son apport spirituel, la simple manière dont elle est émise est un vrai plaisir de lecture. Philippe Kerr est un écrivain complet, il a décidé de nous conter une histoire d’espionnage, d’hommes déchus, de survivants, de femmes fatales, et, comme à son habitude, une histoire d’Histoire. C’est ce qui est le plus fascinant, au delà de son habileté d’écriture, – les dialogues par exemple, lorsqu’il s’agit de faire parler ces sortes d’aristocrates anglais des années cinquante, un peu « pédérastes », « Suaves, reptilien, et suintant le dédain. ». « Incarnation du scélérat bien élevé et sardonique. » Les dialogues sont savoureux et précis, quelle réussite (il s’agissait tout de même de mettre en scène un des plus grands écrivains de son époque). Il y a tous ces personnages et toutes ces images d’une époque, une analyse sur le lien du secret entre espions anglais et homosexuels, tout aussi anglais, le genre d’attitude était alors réprimandé par la loi dans leur propre pays. Pays dont ils défendaient la cause, nous sommes en pleine guerre froide, et puis, il y a notre détective privé préféré, Bernie Gunther, survivant de guerre, de trahisons, d’histoires d’amour et d’amitié. Il officie en tant que concierge au Grand Hôtel. Dès le départ, cette simple allusion, rend hommage, et ce ne sera pas le seul, aux romans de John Le Carré. On pense au titre « The night manager », mais bien sur, sur toute la deuxième partie de l’histoire, il s’agit de « La Taupe », cette histoire d’espion infiltré durant des années dans les services secrets Britannique et travaillant pour les Russes. On retrouve les noms des protagonistes, à commencer par le fameux Philby !
Encore une fois, et même si vous ne connaissez pas ses romans, Philippe Kerr manie le roman policier avec art. On a beau aimer le roman noir, le polar, il n’en est pas moins qu’on a tous commencé par lire des Arsène Lupin, Sherlock Holmes et Agatha Christie, de grands classiques, et c’est ce genre de lectures, réactualisées au goût de l’Histoire avec un grand H, que nous livre l’auteur. Il y a du Hercule Poirot dans ces personnages millionnaires ou aristocrates profitant de la beauté et des charmes de la Côte d’azur. Cela débute simplement, une histoire de chantage contre un grand écrivain anglais homosexuel, on embauche le concierge de l’Hôtel, Bernie / Walter, qui se cache de son passé, de lui même aussi, c’est un personnage profond, couvert de blessures, d’amour propre et de dignité, témoin de ses propres erreurs, et, comme il le dit lui-même : survivant.
À partir de là, surgit le talent de Kerr, la Vérité, l’Histoire, il nous parle des drames de la deuxième guerre mondiale en Europe, mais, comme à chaque fois, vu par un Allemand lambda, ni nazi, ni guerrier, c’est nous montrer que la guerre est faite par les politique et des extrémistes pour ravager des populations, il y mêle mystères et rapport de forces, liés à la corruption et à l’inhumanité des dirigeants ou pire, profiteurs de ces situations, en parlant, par exemple de la légendaire Chambre d’Ambre, et déjà nous sommes dans les jeux d’espions, il raconte aussi le sort des homosexuels allemands sous le régime d’Adolf Hitler, et dès 1933, que ceux-ci soient des généraux, ou de simples citoyens, leur traitement était impitoyable.
Mais il s’agit avant tout d’un roman policier doublé d’un roman d’espionnage, le rythme est prenant, les rebondissements et révélations s’empilent, et de plus en plus dans la dernière partie, double-jeu, ancien ennemi avec qui l’on doit coopérer, bluff, soupçon, trahison, retournement, c’est tellement prenant, d’autant plus que cela sort directement d’une réalité vécue par les uns et les autres en ces années précises. Il nous décrit si bien la vie de cet écrivain passionné d’art et de peinture et de sa cour sous le soleil calme de la Riviera française (et si vous aimez le bridge, votre plaisir sera double, les analogie par rapport à ce jeu sont multiples), les senteurs de ses jardins, la beauté de ses petites villes, de Eze à la Turbie, il nous emmène même faire un tour dans la rue Obscure de Villefranche, pour ceux qui connaissent, un vrai régal. Il y aussi des clins d’œil à des « personnages » de l’époque (Pierre Brunneberg, le maître nageur de l’hôtel, « il avait appris à tout le monde, de Picasso à David Niven » – avec sa si particulière pédagogie que je vous laisse découvrir).
Mais la cerise, au-delà de l’Histoire dans l’histoire (Histoire passée et du moment, on est en plein conflit sur le Canal de Suez), des descriptions, des ambiances et des dialogues savoureux, passes d’armes ciselées, réparties désuètes et belles, la cerise c’est Bernie Gunther. Un vrai détective de roman noir ; désabusé, trahi, ballotté, castagné, et surtout, doté d’un humour ravageur et sombre ; « On aurait dit que mes couilles avaient passé la nuit sur une table de billard de brasserie. » Comme d’habitude, nous autres Français, en prenons pour notre grade, mais, ça va, les Anglais et les Américains ne sont pas en reste, de même qu’il fustige ses propres compatriotes de l’époque, « Avec sa moustache en brosse à dent et son élégante tunique du parti, Koch ressemblait à l’effigie d’Adolf Hitler sur un carnet de rationnement. J’avais déjà vu des nazis plus petits, mais seulement dans les jeunesses hitlériennes. » Même si son enracinement à l’Allemagne et à Berlin, dont il nous narre le destin sous le rideau de fer, aussi bien que lors de son époque festive dans les années 20, reste plein de mélancolie. Et bien sûr, il n’omet pas les Russes, rappelant les outrages et la barbarie sans-nom qu’ont subie les femmes et filles des petites villes d’Allemagne lors de l’invasion des troupes de Staline.
Bien sur, à la fin, malgré les nouvelles cicatrices, malgré les petites victoires, les gnons et encore plus de secrets enfouis, l’Histoire continue, et, pour notre plus grand plaisir, celle de Bernie Gunther.
Du Philip Kerr, du Bernie Gunther tout craché, savoureux, violent et mélancolique, du Grand Art.
JOB.
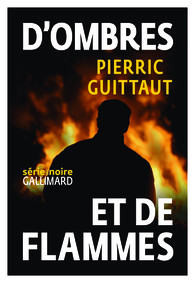


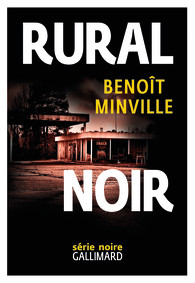



Commentaires récents